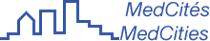GUIDE
pour l’élaboration des Stratégies de Développement des Villes
Questions fréquemment posées
Sans être exhaustive, la série de questions-réponses ci-dessous donne un aperçu des questions fréquemment posées et propose des réponses qui peuvent aider à la compréhension et la résolution de problèmes qui se présentent aux acteurs et animateurs de la SDV. Il demeure évident que la particularité de chaque SDV suppose une adaptation de la réponse à chaque situation afin de mieux se conformer au contexte local et d’apporter la réponse la plus pertinente.
Q : Comment peut germer l’idée de lancer un processus de SDV ?
R : D’une façon générale, les stratégies de développement des villes ont été ressenties par les autorités locales comme une étape nouvelle qui vient compléter et enrichir les instruments de planification urbaine classiques, notamment en prenant en charge les domaines absents dans les instruments classiques (économie locale, finances locales, administration et gouvernance, environnement, changement climatique, etc.). Résultat des délibérations au sein des conseils municipaux et des forums publics, l’idée, une fois mature, est prise en charge par le maire et/ou le conseil municipal et le processus est engagé.
Dans les pays du sud, les partenaires au développement et les agences de coopération (Banque Mondiale, ONU-Habitat, Alliance des villes, Medcités, etc.) ont souvent suscité l’idée en sensibilisant les responsables locaux et nationaux au travers de forum et conférences spécialisées (Forum urbain Mondial, Africités, Objectifs du Millénaire pour le développement, etc.), qui, à leur tour motivent les responsables locaux et engagent le processus.
Q : Faut-il que tous les acteurs soient motivés et mobilisés avant d’engager le processus ?
R : Cette situation (où tous les acteurs sont rapidement motivés par le projet) se présente rarement. Le processus peut-être engagé dès que les principaux acteurs (représentants de l’administration locale, du secteur privé et des principales ONG ou représentants de la société civile) ont marqué leur intérêt. En fait le démarrage du processus devrait agir comme catalyseur et attirer les acteurs initialement indifférents (voire réticents) dans le processus, indiquant, le cas échéant, un début du succès de la SDV.
Q : Peut-on engager la SDV en deux étapes distinctes (une étape préparatoire et une étape d’engagement effectif du processus) :
R : Sans être obligatoire, cette approche pourrait effectivement être la plus efficace dans la mesure où elle permettra de prendre le temps non seulement de laisser mûrir les objectifs de la SDV en les discutant avec toutes les parties prenantes potentielles, mais aussi, et précisément grâce à cette concertation, de démocratiser l’approche et de garantir une participation large et effective.
Q : Comment s’assurer du soutien des autorités centrales et est-il nécessaire d’avoir leur aval ?
R : Il est souhaitable que les services déconcentrés de l’Etat au niveau local soient impliqués dès le démarrage du processus SDV, car une grande partie des investissements en matière d’équipements collectifs et d’infrastructures au niveau local sont le fait de ministères sectoriels (équipements, éducation, santé, culture, etc..).Cette implication doit être « institutionnalisée » par la participation des services déconcentrés ou agences de l’Etat dans le comité technique, dans les groupes de travail et naturellement dans les différents ateliers et manifestations qui jalonnent l’ensemble du processus SDV.
Q : Comment se fait la participation des bailleurs de fonds au processus, notamment pour son financement ?
R : La participation des bailleurs de fonds et de la coopération internationale peut être envisagée à deux niveaux :
- Pendant la phase analytique sous forme de financement des travaux de cette phase et/ou de soutien technique. A titre d’exemple de participation il est utile de se référer à la procédure de l’Alliance des Villes (http://www.citiesalliance.org/ca/how) dont le Fonds Catalytique propose des financements de développement de la phase analytique de la SDV à travers un processus compétitif de sélection (http://www.citiesalliance.org/ca/CATF_FAQ). D’autres institutions (Banque mondiale, Medcitiés, les agences de coopération bilatérales et bailleurs de fonds) peuvent apporter également un concours à cette phase.
- Pour la réalisation du plan d’action, les bailleurs de fonds internationaux peuvent accorder des financements selon les accords avec le pays concerné.
Q : Faut-il ne lancer une SDV qu’après la formation d’une nouvelle équipe dirigeante locale (donc après les élections municipales) pour éviter le ralentissement ou l’arrêt du processus en cas de changement de l’équipe dirigeante ?
R : Il est souhaitable que l’initiative soit lancée en début du mandat de l’équipe municipale. Toutefois si l’équipe dispose encore d’une période confortable pour le développement du processus (au moins deux ans) l’exercice est possible. Dans le cas où l’initiative provient des autorités locales (gouverneur, wali) l’équipe municipale gagnerait à s’impliquer quelle que soit la durée restante de son mandat.
Q : Quelle est la durée moyenne des différentes phases nécessaires à l’élaboration d’une SDV ?
R : A titre indicatif et sur la base de l’observation des SDV réalisées dans la région PSEM, les délais suivants peuvent être retenus pour une estimation approximative de la durée du processus :
- la préparation du lancement de la SDV : 2 à 3 mois
- l’élaboration de l’état des lieux et le diagnostic participatif : 6 à 8 mois
- la mise au point de la vision stratégique : 2 à 3mois
- la définition des axes stratégiques : 2 à 3 mois
- la définition du plan d’action de la SDV : 2 à 3 mois
- la préparation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la SDV : 4 mois
Q : Quelle est la durée sur laquelle on doit projeter la vision ?
R : 15 à 20 ans, toutefois il est important que les stratégies qui seront produites soient articulées sur le court, moyen et long terme selon la nature des actions et activités à mener. De même il sera nécessaire de procéder à des mises à jour périodiques afin de préciser et ajuster les activités, notamment celles portant sur le long terme.
Q : Comment la ville peut-elle mieux réussir à mettre en œuvre le plan d’action de la SDV?
R : Etant donné que les moyens financiers des collectivités locales dans les PSEM sont faibles, une SDV réussie est celle qui depuis son lancement jusqu'à la réalisation de son plan d’action est à l’écoute du secteur privé, des administrations centrales et des organismes financiers internationaux car ce sont ces acteurs qui permettent de réaliser le maximum des investissements prévus par le plan d’action. D’où la nécessité de prendre en considération, tout au long du processus, les actions de ces différents acteurs afin de les intégrer dans le cadre de cohérence des actions de développement qu’est la SDV.
Q : Comment impliquer les groupes sociaux peu ou faiblement motivés ?
R : Il s’agit là d’une des principales difficultés du processus participatif. La réussite de la SDV dépendant du niveau de participation de tous les acteurs, les initiateurs et les champions du processus doivent rechercher les voies et moyens pour mobiliser ces acteurs en faisant appel à des rencontres directes avec les groupes en question (femmes, habitants des quartiers défavorisés, emploi informel, chômeurs, jeunes, etc.) et dans certains cas l’intermédiation de personnalités connues et écoutées (artistes, religieux, bienfaiteurs, etc.).L’appui des médias peut enfin, être, très utile.
Q : Comment peut-on faire une bonne validation du travail des experts :
R : Les rapports des experts doivent être considérés comme des études et propositions faites par des hommes de métier mais qui n’ont pas nécessairement les mêmes préoccupations ni les mêmes attentes que les autorités locales. Les rendus des experts doivent donc faire l’objet d’une appropriation par ces autorités et par les membres du comité de pilotage qui doivent analyser, commenter et réviser les rapports afin que le produit final ainsi obtenu traduise les objectifs et attentes de la ville. Le comité de suivi technique veillera à résumer, synthétiser et souligner les éléments les plus importants des rapports afin de faciliter la tâche des membres du comité de pilotage.
Q : que peut-on mettre sur la page web de la SDV :
R : La page web fournira à ceux qui la consultent les éléments d’information nécessaires pour la compréhension de la SDV (son objectif, son processus, les différentes parties prenantes et leur rôle respectif). Pour cela il est important que les évènements et étapes importantes de la SDV soient rapportés dans un format facile à comprendre par tous. Il peut être très intéressant de personnaliser la page web en y postant les photos des événements, des personnes actives dans le processus, ainsi que celle des projets et parties de la ville qui sont appelées à bénéficier de la SDV. Cela permettra aux citoyens de se reconnaître dans la SDV et, partant, de s’y associer.
Q : Que sont les projets à « gain rapide » et comment les choisir?
R : Un projet à gain rapide est un projet qui est en cours de préparation ou déjà maturé, dont la mise en œuvre peut être rapidement engagée et qui correspond aux objectifs de la SDV. Il est fortement recommandé d’identifier de tels projets qui, en général, disposent déjà de leur financement, et dont la réalisation donnera un contenu concret de la SDV et visible pour les citoyens. Cette solution a l’avantage de démontrer que la SDV n’est pas un processus exclusivement analytique ou un simple exercice de réflexion et d’études (réflexions et études à l’égard desquelles les responsables et les acteurs ont souvent développé une certaine réserve voire répulsion) mais qu’il s’agit bien, in fine, de la concrétisation, aussi rapidement que possible, de ces réflexions en actions et réalisations. La gamme de projets à gain rapide est très large et va de la mise en place de moyens de collecte de déchets solides dans les quartiers défavorisés, de l’éclairage public pour améliorer la sécurité dans certains voisinages, de reboisement, de curage d’égouts, de programmes collectifs d’amélioration de l’environnement urbain, etc. Les autorités veilleront à placer, de façon bien visible, ces programmes dans le cadre de la SDV, en procédant, par exemple, au lancement officiel du projet dans le cadre d’un évènement de la SDV (forum, ateliers, etc.).