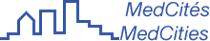GUIDE
pour l’élaboration des Stratégies de Développement des Villes
Principes et fondements de la SDV
Les décennies du milieu du siècle dernier, en particulier les années 50 et 60 ont marqué l’apogée de la planification urbaine basée sur l’élaboration et l’adaptation de schémas directeurs du développement spatial, vue comme la panacée en matière d’organisation de la ville et de son extension harmonieuse, rêve d’un nouveau monde urbain. Cependant dès les années 80, au moment où les idées néolibérales commençaient à être dominantes, un essoufflement de cette forme de planification a été constaté, car elle n’atteignait souvent plus les objectifs qu’elle s’assignait et cela du fait, d’une part, du coût de cette procédure pour les pays en développement et, d’autre part, des délais qu’exigeait la production de plans. Déjà sérieux, ce problème se trouve aggravé par le fait que ces plans étaient rarement mis en œuvre, notamment dans les pays en développement où la ville réelle n’était pas celle qui avait été pensée et planifiée et où l’urbain informel a bouleversé les projections et les plans de la ville que l’on voulait organiser.
L’action des grands organismes internationaux en direction de l’urbain (Onu-Habitat, Banque Mondiale, etc..) a eu un impact déterminant sur la configuration des politiques publiques urbaines aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Aujourd’hui, le mode de penser et d’agir sur l’urbain est le résultat cumulatif d’un processus de réflexion et d’actions qui a duré trois décennies environ. Dans cette marche, on peut distinguer trois phases qui montrent, dans les villes des pays en développement, le passage progressif d’une approche sectorielle orientée exclusivement vers le traitement des problèmes urbains (bidonvilles, infrastructure, pauvreté urbaine etc.) à une approche où la ville est perçue, d’une part, d’une façon positive et est considérée, d’autre part, comme une entité (dans l’esprit d’un « système de ville»), qui doit être étudiée et traitée en procédant à l’analyse de ses forces, de ses faiblesses et des opportunités qui s’offrent à elle, tout en mettant l’accent sur le rôle essentiel de l’ensemble des acteurs qui font la ville. Cette approche met :
- Le pouvoir local au cœur de la conception et de la concrétisation du processus de développement urbain
- La participation des acteurs locaux (élus, associations, simple citoyens, administrations, etc..) comme une condition sine qanun pour la réussite d’un projet de développement urbain.
- Le partenariat public-privé au niveau national et international comme clef de mise en œuvre des plans d’action issus des projets de développement urbain.
La SDV est donc une autre manière d’aborder la question du développement économique, social et spatial de la ville « La Stratégie de développement de ville [comme] un plan d’action, pour une croissance équitable de la ville, élaboré et conduit à travers la participation de tous en vue d’améliorer le niveau de vie de l’ensemble des citoyens. Les éléments en sont :i) une vision collective de la ville, ii) un plan d’action pour améliorer la gouvernance et la gestion, accroitre l’investissement, développer l’emploi et les services et des programmes systématiques et durables de réduction de la pauvreté. Il est attendu de la ville qu’elle dirige le processus et le leadership local est essentiel (…) Une SDV focalise sur le processus de changement. (…) Elle est centrée sur la ville comme unité d’analyse…. Elle augmente sa capacité à tirer le meilleur de ses forces et des opportunités que lui offre son environnement pour améliorer sa compétitivité, sa résilience et contribuer au développement régional et national » . Par son caractère innovant et volontariste, |
SDU ou SDV ? La Stratégie de développement urbain (SDU) et la Stratégie de développement de Ville (SDV) sont deux termes synonymes, ils désignent tous deux une méthodologie et un processus complémentaire à d’autres outils de plani?cation urbaine qui aboutissent à la dé?nition d’un produit plus holistique assurant le développement économique, social et spatial de la ville. La SDV est le terme le plus adopté dans la littérature spécialisée et dans les documents de l’Alliance des Villes. Contrairement à la SDU, le terme SDV ne risque pas d’être attribué aux documents classiques de la planification urbaine. |
|||
| la SDV complète l’approche classique de la planification urbaine qui a montré ses limites dans le contexte des changements rapides que connaissent les villes aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. D’une façon générale les facteurs qui militent pour qu’une ville adopte l’approche SDV peuvent se résumer en cinq points : | ||||
- La SDV est un outil de leadership, qui permet aux dirigeants locaux d’avoir une vision claire du développement de leur ville et de mobiliser les acteurs publics et privés pour s’approprier cette vision.
- La SDV est un outil participatif, qui offre la possibilité d’impliquer tous les acteurs de la ville pour contribuer d’une manière ou d’une autre au développement de leur ville.
- La SDV est un outil de développement multisectoriel à large spectre, qui permet d’aborder tous les aspects urbains : économiques, politiques, sociaux, environnementaux etc.
- La SDV est plus qu’un plan économique et social ; elle est, par définition, territorialisée et intimement liée à la planification urbaine. Par ses orientations à long terme elle complète les outils de planification spatiale légaux.
- La SDV est un outil de planification stratégique permettant la mise en place des actions à court terme dans le cadre d’une stratégie à long terme.
L’atteinte totale ou partielle des objectifs mentionnés ci-dessus (pour une ville donnée) dépend du niveau de conception de la SDV et de la qualité de sa mise en œuvre qui sont directement liés au niveau de la gouvernance urbaine nationale et locale.