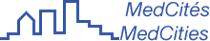GUIDE
pour l’élaboration des Stratégies de Développement des Villes
Chapitre 1 La préparation du lancement de la SDV
1.1 Objectifs et préalables
1.1.1 Définition
La phase préparation du lancement représente le démarrage officiel du processus SDV et confirme l’engagement des responsables locaux à la mener à bien. Elle est destinée à mettre en place les conditions de réussite de tout le processus d’élaboration. Au cours de cette phase :
- Sont mises en place les instances nécessaires au pilotage du processus et à l’élaboration de la SDV,
- Sont identifiés les acteurs et partenaires potentiels du processus,
- Est défini le programme de travail pour l’élaboration de la SDV.
- Est assurée une large communication autour de la SDV pour sensibiliser et mobiliser toutes les parties prenantes.
Cette phase est cruciale et doit être conduite avec une grande attention pour assurer un développement fluide et efficace du processus dans la ville qui en fait l’expérience, souvent pour la première fois.
Elle est initiée par un chef de file qui possède l’autorité politique l’habilitant à engager le processus et l’autorité morale nécessaire pour la mobilisation de tous les acteurs autour du projet. Dès cette phase les acteurs appelés à participer au développement du processus sont identifiés et mobilisés, notamment : les élus et les gestionnaires de la ville (chefs de services techniques de la municipalité, des universitaires, les médias, des personnalités en vue, des représentants de la société civile, des femmes, des jeunes, des habitants des quartiers défavorisés, le secteur privé, les chambres de commerce, du tourisme, etc.). Les ressources financières pour conduire le processus d’élaboration de la SDV doivent être évaluées et les fonds mobilisés au niveau interne (budget de la municipalité ou de l’Etat) ou externe (financement par des partenaires multilatéraux ou bilatéraux).
1.1.2 Objectifs
L’objectif central de cette phase est de :
- Mobiliser et susciter l’enthousiasme et l’engagement du maximum d’acteurs autour du processus SDV, en impliquant les médias le plus tôt possible. La participation de journalistes spécialisés et motivés permettra une couverture et une information continue en direction du public.
- Déterminer, sur la base d’une approche participative, les priorités et thèmes centraux qui seront étudiés dans le processus d’élaboration de la SDV,
- Assigner les tâches, missions et responsabilités aux différents acteurs,
- Solliciter, le cas échéant, le concours (technique et/ou financier) de partenaires internationaux. Si ce recours à l’assistance de partenaires internationaux est nécessaire, prévoir de les associer à la réflexion le plus en amont possible.
Recommandation : Il est recommandé que le chef de file (maire, gouverneur, wali) marque de façon explicite et forte son rôle. Toutefois il doit rapidement s’assurer que d’autres acteurs s’approprient très vite le processus et en soient des défenseurs engagés. |
1.1.3 Préalables
Pour que le processus soit engagé sur des bases saines, il y a lieu :
- De s’assurer d’un fort soutien politique non seulement au niveau local (gouverneur, wali, maire, conseil municipal, personnalités et groupes influents), mais aussi au niveau central (ministères chargés des collectivités locales, de la décentralisation, des finances, etc.),
- D’impliquer le plus tôt possible la société civile au travers de ses représentants,
- De mobiliser les capacités techniques de la ville (universités, experts reconnus, associations professionnelles,
- D’associer en toute transparence les médias,
- De crédibiliser le processus par la présence de pairs (autres maires ou gouverneurs) aux cérémonies de lancement.
Recommandation : La participation des médias sera efficace et continue si elles ont la certitude que l’accès à information et sa communication au public est libre. Dans ce cas pourront émerger des champions de la SDV très utiles pour sa défense et sa dissémination dans et au-delà de la ville. |
1.2 Déroulement de l’étape
1.2.1 Les principales tâches à engager et les acteurs
a. Mise en place des instances de pilotage et de suivi :
la conduite d’un processus d’élaboration d’une SDV nécessite la mise en place de plusieurs instances (voir détail des missions et de la composition de ces groupes en annexe I), notamment :
- Le comité de pilotage chargé du pilotage, des orientations politiques du processus et de la validation des différentes étapes et des résultats. Ce comité a également un rôle essentiel dans la mobilisation des acteurs et la garantie de la bonne gouvernance du processus. Pour l’efficacité de son action, ce comité ne devra pas réunir plus d’une dizaine d’acteurs clés.
- Le comité de suivi technique : c’est la cheville ouvrière du projet. Il est notamment chargé de réaliser ou de faire réaliser les différentes activités techniques et l’animation des différentes phases. Il rend compte au comité de pilotage et en assure le secrétariat. Il pourrait être localisé au niveau d’une structure qui détient une fonction de coordination au niveau de la ville et qui a un contact direct avec le chef de file, exemple le département de planification de la municipalité ou son équivalent.
- Les groupes de travail : un groupe de travail spécialisé sur chacune des thématiques de la SDV assiste le comité de suivi technique. Composé d’experts ou de parties prenantes directement concernées, chaque groupe de travail apporte une contribution technique et alimente le processus d’analyses, de recherches, de propositions et, dans certains cas, de collecte de données et de documents de référence.
b. Définir les objectifs, le programme de travail et l’étendue du processus :
Parmi leurs premières tâches, les instances de pilotage devront arrêter avec les parties prenantes et les acteurs qui seront impliqués dans le processus les éléments importants suivants:
- La définition des axes thématiques qui feront l’objet des analyses et évaluations et formeront la trame du processus de la SDV : Cette tâche est très importante et pourrait requérir la participation de professionnels avertis des problèmes que rencontre la ville mais sera nécessairement discutée avec les autres acteurs. Il sera également utile de prendre note des travaux qui auront été déjà réalisés dans des domaines connexes (plan d’urbanisme, agenda 21, concertations publiques, etc.) afin de s’en inspirer, le cas échéant. Cet exercice sera important lorsqu’une assistance technique et/ou financière est sollicitée auprès d’institutions internationales ou de bailleurs de fonds. On pourra se référer également, à titre d’information, au tableau en annexe III donnant une liste indicative de thèmes qui ont été considérés dans des SDV de la région et ailleurs. Dans l’hypothèse où les autorités sont dans le doute quant aux actions prioritaires permettant d’améliorer la gestion et le développement de la ville, il est recommandé d’élaborer un profil rapide de la ville tel que précisé dans le chapitre 2 ci-dessous, section 2.2.
- La détermination du territoire de la SDV : Bien que la SDV soit propre à une ville ou à un ensemble de municipalités (généralement contiguës), il est utile que l’arrière pays soit pris en compte en raison des possibles interactions avec le développement de la ville (foncier, ressources hydrologiques, environnement physique, flux de populations, bassin de travail, etc.). Une analyse d’un espace plus vaste que celui de la ville pourra donner des indications précises pour le développement de la stratégie qui sera, quant à elle, plus directement centrée sur la ville elle-même.
- L’élaboration du plan de travail : L’une des premières tâches du comité de suivi technique est de préparer le plan de travail qu’il compte suivre pour élaborer la SDV, définissant, par exemple, sur la base du présent guide, les principales tâches à mener étape par étape et la durée approximative de leur exécution. L’élaboration d’une SDV n’est pas un processus précipité. L’expérience montre qu’il faut procéder à un équilibre entre une durée suffisamment longue pour permettre des analyses, recherches et consultations approfondies et un temps suffisamment court pour ne pas créer un sentiment de fatigue parmi les partenaires et faire chuter leur enthousiasme. Une durée de 16 à 24 mois est recommandée, les SDV élaborées sur une durée de moins de 16 mois sont rares.
c. Mobilisation des représentants de la société civile, des institutions et des groupes sociaux concernés :
Tous les segments et catégories sociales devraient pouvoir apporter leur contribution au processus et le soutenir. Les institutions de pilotage devront s’employer, sous l’autorité morale du chef de file, à mobiliser ces groupes, généralement au travers de leurs représentants, quand cela est possible. C’est aussi durant cette phase que les institutions existantes qui jouent un rôle dans la gestion, le fonctionnement et le développement de la ville (santé publique, social, économie, planification spatiale, développement économique, jeunesse, etc.) doivent être mobilisées et associées au processus afin de gagner leur adhésion et soutien. De même, une forte action de lobbying doit être menée avec les institutions centrales concernées et leurs représentants au niveau local.
Les élus, en tant que représentants de la population, seront appelés, dès cette phase, à jouer un rôle important de mobilisation de leurs électeurs.
Recommandation : Il est crucial que le processus ait l’aval et l’adhésion du conseil municipal. Le chef de file personnifie la SDV. Son engagement politique permettra de susciter l’adhésion des autres acteurs et d’élargir la base du leadership afin que, en cas de départ du chef de file, le processus ne connaisse pas de rupture ou d’arrêt. |
d. Lancement officiel du processus:
La première phase de préparation du lancement de la SDV sera conclue et officialisée par la tenue d’un forum ouvert à toutes les parties prenantes. Les objectifs de ce forum sont multiples :
- Procéder à l’annonce officielle de l’engagement d’une SDV pour la ville,
- Confirmer le mandat du comité de pilotage, du comité technique et des groupes de travail et consacrer l’engagement de leurs membres,
- Affirmer le soutien du processus par les plus hautes autorités,
- Confirmer l’approche participative et l’engagement des institutions de pilotage d’associer tous les groupes sociaux concernés,
- Arrêter ensemble les priorités et thèmes qui feront l’objet des analyses et évaluations,
- Distribuer les tâches et confirmer la participation des différents acteurs,
- Annoncer et discuter un plan de travail préliminaire.
Recommandation : Bien que plusieurs mois séparent encore cette phase de celle de mise en œuvre effective des plans d’actions produits par la SDV, il est recommandé de pressentir dès cette étape la structure de mise en œuvre (ou tout au moins son responsable) et l’associer à toutes les phases du processus. |
e. Tenue d’un atelier d’information et de formation au profit de l’équipe SDV :
Cet atelier organisé au profit de l’équipe opérationnelle de la SDV a pour principal objectif de donner à ses membres une information complète et cohérente du processus et à y établir un climat de synergie. Le coordonateur principal de l’équipe SDV animera, en collaboration avec un expert universitaire ou privé (bureau d’études), les multiples activités de cet atelier. Cette mise à niveau peut se faire par les ressources propres disponibles au niveau local si elles existent. Dans l’hypothèse où les ressources locales sont insuffisantes, il pourra être nécessaire de faire appel à des ressources extérieures nationales ou internationales. L’atelier doit comprendre un volet formation qui vise à donner aux participants une maitrise des connaissances et des techniques à appliquer aux éléments suivants :
- Les méthodes de recherche et de collecte de l’information ;
- Les approches participatives ;
- Le mode de confection des livrables du processus SDV : Etat des lieux, diagnostic participatif, synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, vision d’avenir, objectifs et axes stratégiques, programmation et budgétisation ;
- Les outils de suivi et de restitution ;
- Les techniques d’animation des ateliers et forum et la connaissance des dynamiques de groupes.
1.2.2. Les moyens, les techniques et outils
En plus d’équipes enthousiastes et engagées, le processus de SDV exige la disponibilité de moyens et d’outils adaptés aux formes de travail nouvelles que connaîtra ce processus, notamment la communication et l’interaction avec un large spectre d’acteurs, des possibilités de rencontre et d’échange avec un public souvent nombreux et aux préoccupations et intérêts parfois divergents. Un instrument central et incontournable de toute politique réussie et efficace de communication est la réalisation d’une page web et sa gestion par une équipe active et motivée.
Outre ces moyens techniques, un savoir faire en matière d’échange avec les différents groupes et institutions en vue de convaincre et de susciter la participation est nécessaire. Ces moyens, nécessaires à cette phase, seront utiles pendant tout le cours du processus.
Pour cela la ville devra disposer :
- D’espaces de contact pour les forums accueillant un large public (plusieurs centaines de personnes) aussi bien que des salles de travail pour les groupes de travail spécialisés et les discussions restreintes. Les espaces de rencontres seront choisis en fonction des acteurs concernés. Une salle communautaire dans un quartier défavorisé est plus propice à un débat direct et franc avec les habitants de ces quartiers que les salons d’un grand hôtel.
- De personnels ayant les capacités et maitrisant les techniques de travaux en groupe et de communication.
- Des outils de communication faisant appel à des médias variés (radio, journaux, télévision, internet, affichage publique, etc.)
- Des ressources financières suffisantes et fiables pour la conduite de toutes les phases du processus. Si le soutien technique ou financier des institutions internationales est désiré, les premiers contacts devraient avoir lieu dès cette phase et, si possible, en tout début des réflexions.
Recommandation : L’utilisation des moyens modernes de communication et d’échange ne devraient pas conduire à ignorer des formes traditionnelles et locales parfois extrêmement performantes propres à la région et à la ville concernée. Une campagne pour la propreté de la ville pourrait, par exemple, être très efficacement portée par les hommes de religion, des enfants, des conteurs publics ou des groupes de théâtre populaires locaux. |
1.2.3. La validation et la consécration des résultats
L’expérience a indiqué qu’à toutes les phases du processus de la SDV, les parties prenantes, sollicitées pour formuler des propositions, ont une tendance naturelle à soumettre de longues listes, traduisant ainsi des attentes très fortes. Si cette démarche permet d’identifier ces attentes des différents groupes sociaux et professionnels, il n’est pas réaliste de retenir toutes les propositions. Une recherche de consensus doit se faire sur des priorités, la liste finale des propositions sera arrêtée en fonction des ressources disponibles. Le comité technique et les groupes de travail auront un rôle important à jouer dans la recherche de ce consensus et la détermination des priorités et il appartiendra au comité de pilotage de procéder aux arbitrages nécessaires en tenant les acteurs informés des raisons des choix faits.
Ainsi, chacune des étapes du processus fera l’objet d’une validation, une fois les discussions terminées et le consensus atteint. Cette validation, dans l’esprit de l’approche participative, sera conduite de sorte à tenir compte des avis et contributions des acteurs. Les institutions de pilotage joueront un rôle d’intermédiation, si nécessaire, et de mise au point technique des résultats.
A ce titre, et pour cette phase, la validation - par le comité de pilotage et sous l’autorité du chef de file- pourra concerner la formalisation et la validation des propositions faites, en particulier celles concernant les axes thématiques de la SDV, le territoire d’emprise de la SDV, ainsi que les procédures d’analyses et d’évaluations (sélection des experts, délais, nature des livrables, etc.).
1.2.4. Les résultats escomptés
Un bon lancement du processus SDV permettra de mettre en mouvement tout le projet sur des bases saines et solides et d’atteindre les résultats garants d’un processus viable, notamment :
- un leadership clair et accepté par tous,
- une équipe de pilotage motivée, représentative et soudée,
- une équipe technique bien formée, qui connait parfaitement les procédures et les méthodes de travail avec une gamme très diversifiée d’acteurs,
- des acteurs intéressés, motivés et prêts à s’impliquer,
- des modalités de travail et des objectifs de la SDV compris par tous et acceptés.
1.3 Spécificités des PSEM et réponses à apporter à ces spécificités
Les expériences de SDV conduites dans les PSEM ont permis de dégager un certain nombre d’enseignements quant aux spécificités des villes et pays de cette région notamment au regard de leur mode d’organisation administrative, des niveaux de décentralisation et des formes de gouvernance. Il reste entendu qu’au-delà de caractéristiques générales, chaque pays et chaque ville possède ses propres spécificités qui seront prises en compte lors de la réalisation d’une SDV.
1.3.1. Quelques caractéristiques propres à certains PSEM :
Parmi les caractéristiques parfois communes aux PSEM, les travaux de la conférence de Barcelone de mars 2011 ont identifié les suivantes :
- Bien que le processus de décentralisation connaisse une généralisation progressive et à différents stades dans toute la région, le rôle des maires reste souvent subordonné au représentant de l’autorité centrale (wali, gouverneur), ce qui exige, préalablement au lancement de la SDV, des clarifications sur les limites et les champs de compétences de ces protagonistes.
- Les services techniques des municipalités souffrent généralement de faiblesses de moyens et ont des capacités limitées ne leur permettant pas souvent d’embrasser et de prendre en charge toutes les complexités d’un processus SDV. Ceci pourrait se traduire par des difficultés de prise en charge du processus, d’encadrement des experts recrutés et de validation des résultats.
- Le besoin d’un soutien financier mais surtout technique dans la conduite du processus.
- L’absence fréquente d’organisations structurées indépendantes et représentatives de certains acteurs centraux du processus notamment les populations des quartiers défavorisés et informels.
- La mise en place de l’entité de mise en œuvre et de suivi de la réalisation est effectuée tardivement ce qui en réduit l’efficacité et la prise en charge rapide de la mise en œuvre de la SDV.
1.3.2. Les difficultés et risques à surmonter :
En raison de ces situations, un certain nombre de difficultés peuvent apparaître lors de la conduite du processus, notamment :
- Dans les cas d’un leadership fort du chef de file, peut exister un risque d’inhibition des initiatives d’autres acteurs importants (maires de circonscription, membres de l’exécutif communal) et, en cas de départ ou de changement du chef de file, cela pourrait entrainer un ralentissement, voire un arrêt du processus.
- Si la SDV est engagée en fin de mandat du chef de file et/ou du conseil municipal, le changement de leadership qui peut résulter des élections risque de se traduire par un mauvais relais entre l’ancienne et la nouvelle équipe dirigeante et un faible engagement de la nouvelle équipe sur un projet dont elle n’a pas eu la paternité.
- L’absence de compétences techniques au niveau local peut exiger l’appel à des compétences étrangères, souvent peu au fait des réalités locales.
- Le scepticisme des partenaires (populations marginalisées, secteur informel, femmes, etc.) non habitués à être consultés sur les affaires de la ville.
- Enfin, les autorités centrales pourraient, si elles ne sont pas suffisamment informées, marquer leur réserve voire leur suspicion à l’égard de la SDV.
1.3.3. Les moyens pour surmonter les risques et difficultés dans le contexte des PSEM
Les acteurs engagés dans le processus seront appelés, à chaque étape, à surmonter les difficultés qu’un processus complexe comme la SDV ne manquera pas de rencontrer. Les réponses suivantes peuvent contribuer à surmonter ces difficultés :
- Le risque lié à un leadership trop fort peut être atténué par l’élargissement de la base de prise de décision à tous ceux qui pourraient démontrer des capacités de leaders de groupes. Cela contribuera également à mettre concrètement en pratique les principes de subsidiarité et de démocratie locale.
- Un choix judicieux de la période de lancement d’une SDV permettrait d’engager le processus en début de mandat d’une assemblée municipale et éviter les risques liés au changement de leadership.
- La réalisation des études techniques, si elle doit être confiée à une assistance technique étrangère, devra associer des compétences locales pour apporter l’éclairage nécessaire sur les réalités de la ville et assurer la pérennité du processus.
- Des campagnes médiatiques agressives doivent être lancées pour diffuser le message en y associant des figures emblématiques et respectées de la ville.
- La reconnaissance de la pertinence de la SDV et son bien fondé exige une forte campagne de lobbying auprès des autorités de tutelle et du gouvernement central.