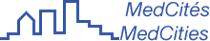GUIDE
pour l’élaboration des Stratégies de Développement des Villes
Chapitre 5 La définition du plan d’action et le phasage
5.1 Objectifs et préalables
5.1.1 Définition
Le plan d’action est la traduction des axes stratégiques de la SDV en programmes et en projets destinés à être mis en œuvre. Outre l’indication des programmes et des projets à réaliser, le plan d’action doit définir les responsabilités, les ressources financières et la durée de réalisation de chaque programme ou projet. Il est le résultat d’accords entre les différents partenaires de la SDV (Voir exemples de plans d’actions en annexe VIII).5.1.2 Objectifs
Cette étape de la SDV permet à la ville de disposer d’une liste d’actions à réaliser à court, moyen et long terme, se présentant de la manière suivante :
- Des actions à court terme, y compris des projets à « gain rapide » (quick win projects) déjà inscrits dans le budget et programme de la ville.
- Des actions à moyen terme par secteur (en prévoyant des mécanismes permettant d’intégrer les plans sectoriels).
- Un plan d’action à long terme traçant les grands traits des programmes destinés à atteindre la vision stratégique.
5.1.3 Préalables
- L’implication, depuis le début du processus, des responsables des secteurs public (et en particulier ceux représentant le gouvernement central) et privé notamment ceux ayant des investissements en cours ou programmés dans la ville, qu’il s’agisse des chambres de commerce, d’industrie ou les entreprises elles-mêmes.
- La validation par les acteurs, publics et privés de la ville, de la vision et des axes stratégiques,
- L’évaluation des perspectives financières de la ville, d’une part, et de sa capacité à mobiliser des fonds locaux, nationaux et internationaux, d’autre part. Ces éléments constituent la base d’élaboration de plans d’actions opérationnels,
- Le lancement d’un plan de formation et de mise à niveau des ressources humaines locales pour mettre en adéquation les exigences de réalisation du plan d’action avec la qualification des ressources humaines disponibles de la ville,
- La mise en place d’une structure de suivi et de mise en œuvre de la SDV, même si toutes les conditions ne sont pas réunies (services et organigramme dédiés, personnel suffisant, locaux etc..).
5.2 Déroulement de l’étape
5.2.1. Les principales tâches à engager et les acteurs
La réalisation d’un plan d’action est un minutieux « dosage » entre des projets réalisables et des projets dont la réalisation dépend de plusieurs paramètres non maitrisables au moment de la réalisation de la SDV (évolution des potentialités financières de la ville, attitude réservée du secteur privé ou public vis à vis de certains projets etc..). L’élaboration du plan d’action passe par un processus de filtrage et d’affinement au sein des instances qui élaborent la SDV (Comité de pilotage, comité technique, groupes de travail, conférence générale etc.). Le plan d’action est le résultat de plusieurs esquisses et des discussions itératives entre les différentes instances, condition de sa crédibilité (même si certaines actions retenues peuvent, à ce stade, paraître non réalisables à court et moyen terme) et de sa capacité à permettre d’atteindre la vision arrêtée par la ville. Le processus d’élaboration d’un plan d’action passe par sept étapes :
- Faire correspondre à chaque axe stratégique les programmes et projets adéquats. Il faut éviter d’encombrer le plan d’action par des petits projets de proximité destinés à répondre aux besoins de base de la population. Ces projets trouvent en général leur réalisation dans les programmes sectoriels courants.
- Accorder la priorité aux programmes et projets structurants. Ceux-ci ont un caractère exceptionnel : ils sont liés soit à la mise en place d’une grande infrastructure, d’un grand équipement, ou l’aménagement d’une partie de la ville etc. Ces projets structurants ont une importance particulière dans le développement urbain et la réussite des SDV. Le guide sur la stratégie de développement urbain de MedCités souligne que « La Stratégie de développement urbain exige un Projet. Sans projets faisables et ayant de fortes retombées économiques, sociales ou territoriales, les stratégies ne sont qu’un exercice d’addition de volontés sans effets réels ».
|
La Stratégie exige un Projet
« C’est pourquoi non seulement nous élaborerons un Plan d’Action comprenant un calendrier, les responsables et les budgets de l’ensemble des projets mais nous identifierons les Projets Structurants qui peuvent faire fonction de moteurs de la ville pour atteindre les objectifs proposés dans le Cadre Stratégique. Par ailleurs, nous élaborerons un travail spécifique plus profond et spécialisé concernant ces Projets Structurants car nous considérons que le succès ou l’échec de la stratégie en dépend grandement » Source : Guide SDDU de Medcités |
Le choix des projets structurants demande d’adopter une démarche innovante et ambitieuse par rapport à la situation présente de la ville. C’est un moment où la participation des personnes extérieurs à la ville et des experts est nécessaire car ils sont susceptibles d’avoir le recul nécessaire pour proposer des projets nouveaux qui n’auraient pas été perçus au niveau local.
- Affiner les programmes et les projets en concertation avec les différents départements ministériels, les agences publiques, les investisseurs et opérateurs privés concernés : l’expérience montre que la plupart des projets inscrits dans les SDV ne dépendent pas de la ville (municipalité et autorité locale) mais d’opérateurs publics (établissements publics, départements ministériels) et privés (promoteurs immobiliers, investisseurs). Par conséquent, il est donc nécessaire d’intéresser ces acteurs clefs du développement urbain au processus de la SDV en leur permettant d’avoir une visibilité sur le développement de la ville ce qui pourrait les inciter à faire plus, soit en améliorant les projets qu’ils ont déjà dans leurs programmes, soit en en proposant d’autres à des horizons temporels définis, soit les deux à la fois.
- Ordonnancer les actions dans le temps : étant donné que la SDV ne peut répondre immédiatement à tous les besoins et à toutes les demandes il est nécessaire d’ordonnancer les actions sur plusieurs années ce qui revient à satisfaire un plus grand nombre de demandes d’une part et à permettre un temps de maturation pour les projets importants, d’autre part.
- Préparer des fiches détaillées des projets arrêtés (voir annexe IX exemples de fiches de projets) : chaque action doit faire l’objet d’une fiche détaillée répondant aux questions suivantes :
- A quel objectif ou axe stratégique le projet contribue-t-il ?
- La nature du projet avec ses caractéristiques principales
- Quels sont les résultats attendus de l’action?
- La consistance exacte du projet
- L’estimation du coût et la programmation pluriannuelle des investissements
- Qui est la partie porteuse du projet (commune, ministère, opérateurs privés ou parapublics, Agence ad hoc) ?
- Le planning de réalisation
- Les indicateurs permettant de suivre l’avancement du projet
- Localiser les projets sur un plan de la ville : présenter des simulations de l’effet des projets une fois réalisés à travers des plans, des maquettes et des photos etc. Finaliser le plan d’actions : le travail des groupes de travail et du comité technique doit aboutir à la finalisation d’un programme prioritaire destiné à être validé par le comité de pilotage et par la conférence générale . Le document à produire, pour entamer ces concertations, sera constitué des éléments suivants :
- Une introduction résumant les axes stratégiques pris comme point de départ de l’étape,
- Des fiches projets et une carte localisant les projets stratégiques prioritaires,
- Un tableau général des investissements envisagés, année par année et par opérateur,
- Un planning de mise en œuvre des actions en précisant leurs sources de financement (budget national, financement extérieur, ressources locales et contribution des différents acteurs)
- Enfin, un court texte qui informe sur l’état d’avancement des concertations avec les acteurs publics et privés, les points d’accord et/ou de divergences et les actions dont la faisabilité doit être discutée à des niveaux supérieurs (services centraux, premier ministre etc..).
Recommandation : Le financement de la SDV est un élément fondamental de sa réussite ou de son échec. Il est donc important que soient inclues, dans le plan d’action, les modalités concrètes de mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation des projets programmés. |
5.2.2 Les moyens, les techniques et outils
Parmi les moyens et outils les plus importants figurent :
- Les plans et programmes nationaux pluriannuels,
- Les prévisions budgétaires des différents départements ministériels,
- L’action de lobbying auprès des bailleurs de fonds internationaux, pour leur proposer des projets à financer,
- Les discussions et concertations avec les différents opérateurs publics et privés, et
- Les conférences, forums, ateliers de travail pour affiner les programmes et projets à inclure dans le plan d’action.
5.2.3 La validation et la consécration des résultats
La phase préparatoire du plan d’action est une phase très importante parce que c’est un moment intense où la discussion d’une succession de plusieurs esquisses a lieu au niveau des groupes de travail, d’ateliers de travail avec les principaux acteurs publics et privés. Cette étape aboutit à la préparation du document dont le contenu est décrit dans le troisième point du § 5.2.1 «les principales tâches à engager et les acteurs ».
Il est suggéré que la validation et la consécration du plan d’action de la SDV se fasse selon une procédure en cinq étapes :
- Le document préparé est pré-validé par le comité de pilotage, après prise en compte des remarques et suggestions de ses membres,
- Présentation du plan d'action à la conférence générale. Cette présentation est précédée d'une large diffusion du plan d'action et de son envoi aux différents acteurs urbains. L’objectif recherché à travers l’organisation de cet atelier est d’obtenir l’adhésion de la majorité des acteurs impliqués dans le plan d’action.
- A ce stade, le comité de pilotage est appelé à examiner les résultats de la conférence générale et l’arbitrage sur les modifications à introduire au niveau du plan d’action pour enfin l’adopter dans sa version finale.
- Présentation du plan d'action aux différents départements ministériels soit dans un cadre institutionnalisé (commission interministérielle) soit dans le cadre d'un forum à organiser.
- L’adoption du plan d’action dans le cadre d’une session solennelle du conseil municipal.
Schéma : processus de validation et de consécration du plan d’action de la SDV
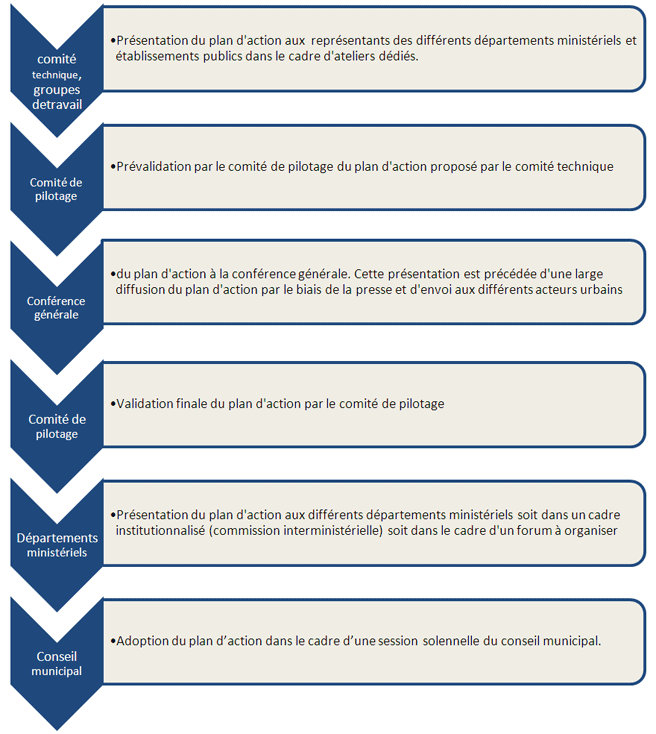
5.2.4 Les résultats escomptés
- Les projets à développer sont clairement énoncés et rattachés aux différents axes stratégiques adoptés,
- Adhésion des bailleurs et des autorités concernées au plan d’action et au plan de financement,
- Engagements clairs sur la mise à disposition/mobilisation des ressources,
- Mobilisation de tous les acteurs sur l’objectif assigné par le plan d’action,
5.3 Spécificités des PSEM et réponses à apporter à ces spécificités
5.3.1 Quelques caractéristiques propres à certains PSEM :
Le rapport sur l’évaluation des SDV dans les PSEM a montré :
- La tendance des villes à proposer des plans irréalistes : la réalisation de plusieurs actions figurant dans les plans d’actions ne relève pas de la compétence de la ville (construction d’hôpitaux, d’écoles, de centre culturel etc.) De ce fait ces actions, malgré leurs pertinences, ne sont validées par aucune institution ; leur réalisation reste donc fictive sauf si elles sont en cours ou programmées en dehors de la SDV et intégrées par la suite dans le plan d’action.
- L’analyse fine des capacités financières des villes et des moyens de les améliorer est très peu évoquée, ce qui fait que les plans d’action sont constitués en grande partie par des projets sectoriels qui relèvent de différents départements ministériels ; la part des projets proposés par la ville est négligeable.
- Parfois une absence de convergence des actions proposées par la ville avec les priorités de financement des bailleurs de fonds.
5.3.2. Les difficultés et risques à surmonter,
Un plan d’action bien conçu est un plan qui répond aux questions suivantes :
- Qui fait quoi et avec quelles ressources ?
- Pendant quelle durée et à quelles dates (début et fin des projets)?
Ceci suppose que la ville a soit, une large autonomie financière et technique pour mobiliser ses moyens, soit la certitude de disposer des ressources en volume et en temps voulus. Cela suppose également une capacité de négociation vis à vis des acteurs publics et privés pour conforter l’action de la ville. Dans cette perspective, les capacités financières et de persuasion de la majorité des villes des PSEM restent, d’une façon générale, encore à construire.
5.3.3. Les moyens pour surmonter les risques et difficultés dans le contexte des PSEM
Ces moyens relèvent du moyen et du long terme :
A moyen terme : Arrêter des priorités précises dans le plan d’action pour mettre en conformité le plan d’action avec les ressources disponibles. Ceci va crédibiliser le plan d’action et par conséquent l’exercice SDV lui-même.
A long terme :
- Améliorer la capacité financière de la ville à travers une gestion plus efficiente des finances locales et de la fiscalité locale ;
- Améliorer le positionnement de la ville par rapport aux acteurs publics et privés en ayant un recours fréquent à l’intercommunalité dans la réalisation de projets, issus de plan d’action, en commun.