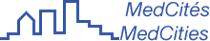GUIDE
pour l’élaboration des Stratégies de Développement des Villes
Chapitre 3 La mise au point d’une vision stratégique
3.1 Objectifs et préalables
3.1.1 Définition
|
La mise au point d’une vision stratégique consiste à conduire un exercice auquel sont invitées toutes les parties prenantes pour exprimer collectivement, en quelques phrases, la vision qu’elles ont de la ville dans le long terme : quelle ville voulons-nous dans un terme de 15-20 ans ? Cette vision, tout en étant volontariste, doit rester réaliste et pouvoir être adoptée par les citoyens. Elle doit refléter les attributs spécifiques à la ville, notamment ce en quoi elle peut avoir des avantages compétitifs par rapport à d’autres villes de la région, ses valeurs, sa place dans l’économie régionale, voire mondiale, ses atouts physiques, historiques et culturels. |
La vision de la ville de Ramallah (Palestine)
“Ensemble, nous cherchons à réaliser une zone prospère bâtie sur une économie basée sur les services et des infrastructures fiables, qui adopte une bonne gouvernance lui assurant la participation publique, le respect des diversités, le droit des citoyens et préserve son environnement ainsi que son héritage” |
La vision pourrait incorporer des images de la ville ou des slogans déjà existants et bien ancré dans la mémoire collective de la ville afin d’assurer une continuité avec le passé (voir, annexe VI exemples de visions).
3.1.2 Objectifs
La formulation d’une vision permet de fédérer tous les partenaires et acteurs du processus autour d’une base sur laquelle sera bâtie la SDV après avoir mis en commun les visions et aspirations de toutes les parties prenantes en créant des opportunités de dialogue entre les différents acteurs de la ville. Elle agit comme un catalyseur et puissant facteur d’unification des différentes composantes de la communauté urbaine autour de ce qui deviendra un projet collectif.
3.1.3 Préalables
Il est essentiel que la formulation de la vision soit un exercice collectif, dans le respect des points de vue des différents groupes et qu’il ne soit pas le produit d’une réflexion du gouvernement local ou de technocrates seuls. Pour cela :
- La recherche d’un débat ouvert et sans complexe doit être poursuivie de façon claire par les autorités,
- Les acteurs doivent, tout en défendant leurs points de vue, respecter ceux des autres et accepter la contradiction.
- Les animateurs du processus de formulation de la vision, tout en évitant de diriger directement les débats, doivent encourager les participants à concilier ambition et réalisme afin d’aboutir à la formulation d’une vision qui puisse effectivement porter la SDV.
- Les organisateurs des débats et notamment le comité de suivi doivent être, au préalable, formés aux techniques de conduite des discussions entre des groupes sociaux diversifiés et aux attentes parfois divergentes.
3.2 Déroulement de l’étape
3.2.1. Les principales tâches à engager et les acteurs
La formulation de la vision est un processus éminemment participatif et qui repose sur une démarche organisée, impliquant les intervenants à différents stades. A ce titre :
- Les groupes de travail, en contact avec leur forum de discussion respectif (voir recommandation du paragraphe 1.2.1.) analysent les rapports diagnostics et études d’état des lieux, pour dégager les premiers éléments sectoriels de la vision, et en livrent les premiers résultats au conseil municipal et autres décideurs au niveau de la ville à la faveur d’un atelier de travail.
- En parallèle une campagne est lancée par le comité de suivi, sous l’autorité du comité de pilotage auprès de citoyens cibles appartenant à différents groupes sociaux professionnels leur demandant de dire leur vision de la ville qui pourra être médiatisée et servira d’instrument supplémentaire d’ancrage du processus dans la ville et son appropriation par les citoyens.
- Les groupes de travail et le comité de suivi esquissent des propositions de visions sectorielles par axe thématique et les soumettent aux acteurs de la SDV lors de Forum/débat en vue de leur validation.
- Le Forum/débat permettra aux acteurs de la SDV de procéder à une consolidation des visions sectorielles en une vision de la ville. Cette étape et notamment le forum/débat s’avèrera être un exercice très utile de négociation entre les différents acteurs et de formation de l’esprit d’appartenance à la ville.
- La diffusion la plus large possible de la vision par le conseil municipal afin d’en faire un référent valorisant de l’identité de la ville, un label et un instrument de promotion de la ville.
Recommandation : les travaux en atelier sont des moments privilégiés pour faire de la formulation de la vision un moment intense de communication autour de la SDV. Les médias y doivent être associés et intégrés dans la campagne de communication de la SDV. |
3.2.2. Les moyens, les techniques et outils
La formulation de la vision requiert la maîtrise des techniques de débat avec une population et des groupes sociaux très différents et, pour certains d’entre eux, exposés pour la première fois à ce genre de manifestation. Plusieurs techniques peuvent être employées pour solliciter la participation et les idées, et en particulier :
- L’organisation d’ateliers de travail pour les groupes restreints et en premier lieu ceux-là même qui sont en charge du processus (les instances de pilotage) pour une compréhension claire et partagée du concept et de sa réalisation,
- Des réunions d’explications avec les groupes non avertis (jeunes, femmes, bidonvillois, etc.). Ces réunions se tiendront de préférence dans l’environnement habituel de ces groupes (maisons de jeunes, foyers féminins, centres de quartiers).
- Le recours à un expert en techniques participatives et dynamiques de groupes pourrait être très utile, notamment pour la recherche de consensus et la résolution de conflits potentiels entre groupes.
- L’utilisation des différents médias pour le partage et la médiatisation de la vision et son adoption très large par les différents segments sociaux : radio, focus groupes, presse écrite, affichage, sollicitation directe de personnalités et de citoyens ciblés afin d’exprimer leurs aspirations et leur rêve quant à leur propre futur et celui de leur ville (voir campagne d’Alep).
- Un site internet interactif dédié à la SDV sera mis en place très tôt pendant le processus et utilisé abondamment pendant cette phase.
3.2.3. La validation et la consécration des résultats
La validation de la vision est, par essence même de la nature participative du processus, faite par les acteurs de la SDV eux-mêmes. Pour cela il est recommandé de préférer une consolidation des différentes visions par les différents groupes sur la base de consensus ; le comité de pilotage pourrait, en cas de multiplicité des positions, valider une solution moyenne en veillant à la partager avec tous les acteurs.
3.2.4. Les résultats escomptés
Le processus d’élaboration de la vision a une grande vertu pédagogique (permettre à tous de comprendre l’objectif ultime de la SDV) et un rôle fédérateur des acteurs et des partenaires aux processus. En outre, des différents débats sortiront une compréhension et un partage réciproque des préoccupations et problèmes de chaque groupe social.
Bien conduit, le processus de formulation fournira à la ville et au profit de ses citoyens une vision réaliste et réalisable qui fédère les efforts et l’enthousiasme de tous les acteurs.
3.3 Spécificités des PSEM et réponses à apporter à ces spécificités
3.3.1 Quelques caractéristiques propres à certains PSEM
Les premières SDV réalisées dans la région ont été marquées, dans cette région souvent plus qu’ailleurs par les éléments caractéristiques suivants :
- Les pratiques de discussions ouvertes et de forums publics commencent à connaître quelques progrès qui devraient s’accélérer à la faveur des bouleversements sociaux qu’a connus la région dans la décennie 2010 et dont le retentissement devrait toucher tous les secteurs, y compris le débat autour de la question du devenir de la ville et la vision qui sous-tend ce devenir.
- La nouveauté de l’exercice tant dans sa dimension technique, que par sa nature franchement politique.
- Une fragmentation sociale et une quête de reconnaissance de la part des plus démunis, exacerbée par des situations économiques souvent difficiles qui affectent directement les plus pauvres. Cette quête de reconnaissance, qui s’est exprimée fortement et parfois violemment, a créé une prise de conscience de ces couches sociales qui s’affirment rapidement comme des partenaires importants de toute décision pouvant les concerner.
3.3.2 Les difficultés et risques à surmonter
A l’instar de plusieurs pays et villes qui ont engagé un processus de SDV, mais parfois plus qu’ailleurs, les pays et villes de la région PSEM rencontrent les difficultés majeures suivantes :
- La grande diversité des partenaires et groupes sociaux se traduit par des attentes très différentes selon les groupes, ce qui traduit des préoccupations et des problèmes parfois opposés. Cela est souvent la source de propositions divergentes, apparemment difficiles à concilier.
- Le concept de vision reste partout une idée nouvelle et difficile à expliquer qui nécessite un long travail de pédagogie. Si ce travail n’est pas fait le résultat pourrait être l’inverse de celui espéré.
- L’enthousiasme des partenaires, impatients de voir leur ville connaître des jours meilleurs et désireux de résultats immédiats, peut conduire à la formulation de visions irréalistes.
3.3.3 Les moyens pour surmonter les risques et difficultés dans le contexte des PSEM
Les pilotes de la SDV seront appelés à consacrer un grand travail d’explication et de contact avec les populations concernées. Pour cela ils veilleront à :
- Utiliser tous les relais sociaux (ONGs, leaders d’opinion, personnalités religieuses, figures respectées de la ville), acquis au concept afin d’appeler les acteurs concernés à donner leur point de vue.
- Multiplier les opportunités de rencontres directes (conférences et ateliers de travail) et indirectes (média, leaders communautaires).
- Utiliser les canaux de contacts les plus appropriés avec les populations (affichages de posters, radio locale, meetings publics).